-
Le point aveugle
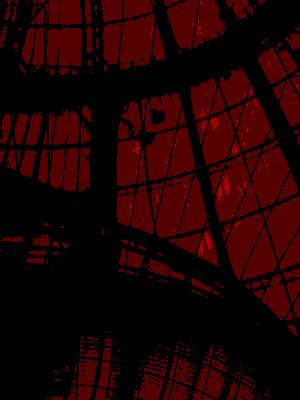
Anish Kapoor
Monumenta
crédit photo anthropia # blog
L’une d’elles qui file à plat sans ciel à l’horizon, elle l’emprunte pour aller à l’école. A cet endroit du carrefour, elles jouent en trio, les rues, elles compartimentent le cadran d’une montre, dans l’espace à sa gauche l’aiguille des heures et celle des minutes, le quotidien des jours, qui se tournent le dos, va-et-vient incertain où elle tente de comprendre la rectitude d’une voie, à sa droite, en à-pic grimpant raide, l’aiguille lente pour les quatre lustres échappés, un chemin généalogique qui monte au cimetière.
Rue de Belfort en deux segments et rue du Crépon, où se croisent l’Histoire, l’univers d’une famille et les accidents de rue entremêlés. Son histoire. Le grand chambardement et les carcasses d’auto se sont alliés pour lui faire une vie, fantômes à elle donnés, on ne sait comment se transmet le relais, il est passé d’un père à sa fille, c'est ainsi. Le grand tour donc, avec quelques viatiques, amitiés et amours et toujours la lecture et la littérature.
La rue principale butte aujourd’hui sur l’usine, juste à côté du collège, sur les vestes de caoutchouc d’un atelier empêtré, l’atelier Mécanique, elle n’a pas toujours su que François, le grand-père, en fut jadis un grand ordonnateur ; quand le ciel rougeoie, qu’il souffle un vent de bise le long de l’Allan, depuis que son courant en a été aspiré par un détournement, ici oui, on détourne les rivières, cry me a river, quand on décide que le capitalisme sera roi, nul obstacle ne résiste, nulle opposition possible et pas d’utilité publique, obtempérez, alors les têtes se baissent, les voisins avoisinent, les paroles de qu’est-ce qu’on y peut y fricotent avec les ça s’ra mieux, cul-de-sac, on reconfigure la rivière et même la nationale, tout le monde de Belfort à Sochaux tombera sur le portail : Peugeot, c’est écrit dessus.
On ne l’aperçoit pas depuis la rue du haut, celle qui domine la plaine, à l’endroit où les enfants viennent jeter leur Schlitt, dix fois, cent fois par jour, remonter la pente et la redescendre en hurlant de plaisir l’hiver dans la neige, -c’est ici qu’on se tient à la verticale du grand ciel, on prend un grand bol d’air, même si en bas s’étalent les autres ateliers, la Carosserie, la Fonderie-, non, dans la rue Sous-la-Chaux, sous les carrières, celle qui menait à la bibliothèque qu’ils ont supprimée il y a quelques années pour y faire un parking, de ces parkings géants aux voitures toutes clonées, espace-automobile, s’il faut le nommer, c’est pour Maupassant qu’on souffre, et pour Jeanne, le livre au plat épais gainé de toile bleue, Une vie, -qu’ont-ils fait du roman ?, l’ont-ils déversé dans un container, allez tiens grand autodafé, jeté avec le Baron et ses maîtresses, qu’ils brûlent tous en enfer-, le récit qu’elle faisait traîner, dont les cinq dernières pages ont ranci sous le lit, (quel temps faisait-il ce jour-là, le ciel grisaillait-il à grands copeaux de blanc, peut-être un brouillard, la peuge ça embrouille, les trésors et la petite maison, sa bibliothèque, trente livres par mois, tous les mois que son sac pouvait porter, depuis qu’elle savait marcher, aller seule dans la rue, parcourir peut-être un kilomètre, en longeant les préfabriqués des Yougos, de jour disait sa mère, c’est plus sûr), non, on ne la voit pas, et après les usines, elle est comme absorbée par le chapelet des maisons qui la bordent, la rue de Belfort.
Le premier à lui avoir parlé du grand-père s’appelle Monsieur Ferrand, souffrant de, chut, sa mère le chuchote, tuberculose, et quand on les murmure ces mots-là, c’est qu’on n’est pas certain qu’on s’en relèvera, on ne le voit pas toujours au café-tabac, et quand il apparait, on devine qu’il en sort, il semble hors du coup, en visite, entre deux séjours au sanatorium. Souvent en rentrant de l’école, celle à côté du Grand Portail, elle le voit appuyé sur une chaise en haut de l’escalier à contempler les nuages, ça risque, c’est pas beau, pourtant il est seul à sourire chez Ferrand, il apporte le vent du large, sans doute le souffle qu’il va chercher loin, si loin qu’on se demande s’il va en revenir, un jour elle est arrivée et il l’a nommée Petite Levinus, son nom reparti en empire romain, qu’est-ce qu’elle en sait, elle, de l’empire romain, peut-être rosa, rosam, elle a onze ans, elle chante, sa première année de latin, j’ai bien connu ton grand-père, tu sais. Son grand-père, elle relève la tête, ce n’est pas un mot pour Sochaux du côté de la nationale, là où l’anonymat pointe déjà le nez, là où entre les blocs où logent les ouvriers et les quartiers à maisons, on ne se connait plus, mais plutôt pour Exincourt, où son grand-père, le Suisse, vit dans le village, où tout le monde se parle, comment l’aurait-il connu, alors elle comprend qu’il lui parle de l’autre, celui qu’on n’ouvre qu’une fois par an, quand le coffre du grenier descend au rez-de-chaussée, que son père sort dans un grand nuage de poussière, pêle-mêle la mandoline aux deux cordes usées, le chapeau haut de forme, quelques vieilles lettres à taches de rousseur, les livres en rouge et or, les Jules Verne, les George Sand, ceux qu’elle va lire en douce l’été à la lueur du soleil qui passe entre les lames du volet de l’oculus, et les photos d’un homme à moustaches, aux cheveux frisés, faisant des lèvres cette moue que son père appelle la madeuse, cet air qu’il dit qu’elle a parfois. Ce grand-père-là, les pleurs de son père l’ont toujours empêchée de le connaître, pas d’histoires, pas de rires, à ce moment où la larme descend sur la joue, elle n’ose plus poser de question, et avant, quand le déballage pique sa curiosité, elle ne pense pas à le faire.
Elle prend la phrase en talisman, en continuant son chemin, elle longe la maison des Mercier, maison de maître à deux balcons, Monsieur dirige la Brasserie du Crépon, ou peut-être n’y est-il qu’ingénieur, en passant devant on sait que la bière est faite de malt et de fermentation, sous l’effet de la bise, qui souffle à rebours de son sens, elle a rabattu son caban pour enfermer son alibi, celui qu’elle aura le soir même pour poser la question, à propos M. Ferrand a dit, pas le jour anniversaire, un jour habituel, peut-être qu’en attaquant par surprise, le rituel du mouchoir va disparaître, on est toujours plus disert quand l’émotion nous prend au saut de la parole.
C’est un soir de juillet. La vallée du Doubs est belle en été, annonce la radio.
Le jardin est en fête. Carte sépia d’un autre temps, la longue allée de ciment bordée d’une collerette de béton gris dresse dans sa longueur des poutrelles équarries ornées d’un treillage, sur lesquelles viennent s’accrocher les épines d’un rosier grimpant à l’ancienne, qui tresse de ses branches une pergola couvrant le chemin embaumant, des roses Sonia, un New Dawn, personne n’a su le dire, de ce rose vivant couleur tendre, présageant déjà sa couleur éteinte. De chaque côté, la nécessité fait loi, les légumes, haricots verts, pommes de terre, petits pois, incursion du côté des tomates, et pour les lèvres, des plans de fraise, alternés avec les arbustes à groseilles, les fines rouges, et puis celles à maquereaux, myrtilles, airelles, toute une terre de cueillette offrant les plaisirs d’un soir gourmand. Dans ses bords, le jardin devient verger, et c’est profusion, cerisiers déjà perdus pour le bonheur des fruits, mais cognassiers prêts pour cuisson, chair de coings écrasée au chiffon. Et les pommiers, pruniers et mirabelliers en fleurs, au fond, un noyer, et puis la haie de noisetiers, branches dont on fait les premières cigarettes, pas encore à maturité, tous espoir d’un automne. Qui n’a connu cette ardeur des arbres à offrir ne sait le paradis terrestre et l’humble contentement de l’homme reconnaissant. Dans ce mois de juillet, elle devine le plaisir que cette famille a dû connaître tout au long d’un jour à finir.
Ils sont cinq, François et Marie, l’aînée, le puîné, la cadette, ils sont rentrés, l’heure du repas. Une soirée de juillet, un coucher de soleil sans doute et puis l’obscurité.
C'est un 16 juillet 1943. Les peupliers de Jean-Pierre sont trop hauts, menace la radio.
Alors son père conte un récit des mille et une nuits, toujours l’histoire d’un verger, la limite de parole, rien avant, rien après, le grondement, l’hypothèse, les avions, puis les bombes, la fuite en famille au-dehors loin des murs, tous allongés. François murmure, se boucher les oreilles et ouvrir la bouche, pour les tympans ; admiratif, le fils obéit, les yeux dans la terre. Reste-t-il encore quelque humus du matin, traces de mousse de velours pour caresser la peau plutôt que la griffer ? Comment luit l’herbe éclairée des feux de Bengale, ceux dressés au ciel, fusées éclairantes en cercle pour faire cible, quels effluves pour l’herbe inondée de salpêtre, de poudre, remplissent-ils le nez qu’on n’a pas pincé ? Comment le visage, le cœur, le corps dans l’attente bruyante, d’abord incertaine, puis si proche, la dernière explosion, avant le redressement quand le silence revient ?
C’était un 16 juillet de l’année 43. La radio se tait.
 Tags : roman, 16 juillet 1943, bombardement de Sochaux
Tags : roman, 16 juillet 1943, bombardement de Sochaux
-
Commentaires
un village au bord du ciel, textes et billets d'art contemporain


