L'entreprise et le monde feutré de l'infra-violence
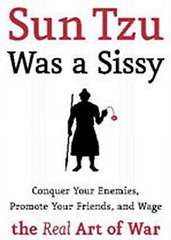
Le viatique indispensable du cadre efficace ne peut plus se concevoir, aujourd'hui, sans une édition poche de L'Art de guerre de Sun Tzu. Voilà bien qui est symptomatique de cette culture qu'on dit "d'entreprise". Oxymore ultime, car s'il est bien un monde où la culture est bel et bien bannie, c'est celui de l'entreprise.
Il n'en reste pas moins, que depuis qu'un jour un abruti quelconque, dans une école de management américaine, s'est mis en tête que le commerce c'était la guerre, les préceptes - possiblement apocryphes et vieux de 2000 ans - d'un général chinois sont d'un seul coup redevenus d'actualité. Ce contemporain de Confucius se serait arrogé le privilège douteux d'établir les bases de la guerre moderne, alors que nos propres ancêtres en étaient encore à s'étriper avec un enthousiasme brouillon. Grâce donc lui en soit rendue.
Cela dit, il n'aura échappé à personne que les plaines boueuses du Yang-Tsé et les plateaux des Montagnes Pourpres qui bordent Nankin - où Sun Tzu conduisit jadis ses campagnes - constituent un théâtre des opérations qui diffère sensiblement de l'atmosphère feutrée des couloirs des grandes officines du commerce international. Même l'effervescence hystérique d'une salle de marché, ne pourrait être comparée au chaos d'un champ de bataille résonnant des cris de douleur et de peur des soldats et du choc mou du métal éventrant la chair. Le complet de marque sied mal à l'engagement physique, et l'attaché case, s'il est possible d'admettre sa nature potentiellement contondante, a un coefficient létal passablement insignifiant.
Réaction en chaîne
Toutefois, faire entrer des références guerrières dans le monde de l'entreprise est assez révélateur des pressions contradictoires que la violence exerce, plus que jamais, sur notre société. Mais pire encore, c'est enclencher une réaction en chaîne qui ne peut qu'échapper à tout contrôle. Il est communément admis que c'est sa capacité à juguler la violence inhérente à l'homme qui détermine aujourd'hui le degré de civilisation d'une société. Et dans notre monde occidental - j'entends par là la frange de l'humanité qui est globalement du bon côté de la balance des comptes - en traquer et en éliminer les symptômes les plus évidents est devenu la norme. En témoigne les nombreuses mesures législatives appliquées aux programmes de télévision ou aux jeux vidéo. Témoin encore, ce désemparement du corps social face aux destructions et aux émeutes des banlieues en novembre 2005. En revanche, lorsque le monde des affaires coopte des valeurs ouvertement guerrières, personne vraiment ne s'en inquiète. Mieux même : par quelque improbable twist sémantique, cette valorisation du culte combattant est facilement admise, et ceux qui abordent le marché avec une attitude de général en campagne sont souvent perçus comme des personnalités véhiculant des valeurs positives. Ils sont dynamiques, volontaires, efficaces. Ce sont des "tueurs". Cette dichotomie dans la perception de la violence s'explique largement par l'illusion de civilisation dont elle s'affuble dès lors qu'elle franchit les limites des quartiers des affaires. Mais ce n'est pas la seule transformation qu'elle ait alors à subir. Car cette glorification du guerrier dans le cadre policé de l'entreprise, débouche sur un paradoxe dangereux. En intégrant à son corpus idéologique une magnification de la violence, l'entreprise, figure ultra-civilisée œuvrant sur un marché prétendument autorégulé - donc un écosystème stable -, place ceux qui y travaillent sous une double contrainte qui ne peut trouver sa résolution que dans une inversion de cette violence. Là où Sun Tzu enseignait à la projeter vers l'extérieur, l'entreprise va, elle, n'avoir d'autre choix que de la retourner contre ses forces vives. Ce ridicule culte de la soldatesque est un greffon stérile, et en transformant bureaux et sièges sociaux en casernes et en PC de campagne, en forçant ses employés à adhérer à cette idéologie combattante, les entrepreneurs instillent dans les rapports une hystérie morbide qui ne fait que dégrader un peu plus les rapports humains et contraint leurs salariés à une vision de plus en plus militaire de leur hiérarchie. Alors bien-sûr, il s'agit d'une violence feutrée. Civilisée. Les armes sont les mots, les rapports de service, les évaluations annuelles, les appendices aux règlements intérieurs, les petites réflexions anodines, qui vous travaillent au corps, comme ces petites séries de crochets au foie qu'on vous enseigne à la boxe. Indolores sur le coup, mais qui vous amènent à la victoire plus sûrement qu'un K.O. C'est aussi parfois les hallalis discrets en salle de réunion. Véritables baisers de la mort, qui portent comme ces coups au Kung Fu, ne laissent pas de trace mais vous tuent deux jours plus tard. Et s'il est vrai que plus on monte dans la hiérarchie, et plus la brutalité des rapports devient visible, il n'en est pas moins vrai que cette violence qui s'initie au plus haut niveau de la chaîne de commandement déborde largement, pour cascader sur les étages inférieurs de la pyramide et se diluer en une infra-violence, certes diffuse, certes d'apparence anodine, mais tout aussi corrosive et sauvage.
Cette dichotomie dans la perception de la violence s'explique largement par l'illusion de civilisation dont elle s'affuble dès lors qu'elle franchit les limites des quartiers des affaires. Mais ce n'est pas la seule transformation qu'elle ait alors à subir. Car cette glorification du guerrier dans le cadre policé de l'entreprise, débouche sur un paradoxe dangereux. En intégrant à son corpus idéologique une magnification de la violence, l'entreprise, figure ultra-civilisée œuvrant sur un marché prétendument autorégulé - donc un écosystème stable -, place ceux qui y travaillent sous une double contrainte qui ne peut trouver sa résolution que dans une inversion de cette violence. Là où Sun Tzu enseignait à la projeter vers l'extérieur, l'entreprise va, elle, n'avoir d'autre choix que de la retourner contre ses forces vives. Ce ridicule culte de la soldatesque est un greffon stérile, et en transformant bureaux et sièges sociaux en casernes et en PC de campagne, en forçant ses employés à adhérer à cette idéologie combattante, les entrepreneurs instillent dans les rapports une hystérie morbide qui ne fait que dégrader un peu plus les rapports humains et contraint leurs salariés à une vision de plus en plus militaire de leur hiérarchie. Alors bien-sûr, il s'agit d'une violence feutrée. Civilisée. Les armes sont les mots, les rapports de service, les évaluations annuelles, les appendices aux règlements intérieurs, les petites réflexions anodines, qui vous travaillent au corps, comme ces petites séries de crochets au foie qu'on vous enseigne à la boxe. Indolores sur le coup, mais qui vous amènent à la victoire plus sûrement qu'un K.O. C'est aussi parfois les hallalis discrets en salle de réunion. Véritables baisers de la mort, qui portent comme ces coups au Kung Fu, ne laissent pas de trace mais vous tuent deux jours plus tard. Et s'il est vrai que plus on monte dans la hiérarchie, et plus la brutalité des rapports devient visible, il n'en est pas moins vrai que cette violence qui s'initie au plus haut niveau de la chaîne de commandement déborde largement, pour cascader sur les étages inférieurs de la pyramide et se diluer en une infra-violence, certes diffuse, certes d'apparence anodine, mais tout aussi corrosive et sauvage.
De la résignation au mercenariat
 La subir au quotidien conduit à une résignation malsaine, où finalement personne - ni employés, ni patrons - ne va trouver son compte. Cette violence réfrénée, ce passage à tabac de la dignité humaine qui se pratique à coup de chaussettes remplies de sable, ne laisse en apparence pas plus d'ecchymoses qu'elle ne laisse de choix. Être chair à canon ou sniper, fantassin ou commando, bref garder son éthique et être sacrifiable ou au contraire l'abdiquer et devenir une machine pour cette guerre sans autre cause qu'une course éperdue aux profits. C'est à dire une guerre de survie. Une guerre d'expansion en somme, mais qui se conduit de l'intérieur, et contre un ennemi désincarné, dont l'omniprésente menace fait planer sur tous un stress mortifère qui ne se résoudra que dans une violence inutile. Cela ne laisse au salarié pour seule solution de repli qu'une défensive résignée. Puisque cette inutile violence se redistribue en interne, on s'interdit tout esprit de corps, et chaque individu n'œuvrera par conséquent qu'à sa propre survie, et exclusivement à elle. Et si on lui demande de se battre, il ne le fera pas pour l'entreprise, par pour le marché, pas pour la hiérarchie. Non ! Il le fera pour garder sa place. Retour de flamme insolite - mais logique - de cette passion guerrière du monde du management : l'esprit mercenaire. Entre les codes ultra civilisés du monde des affaires et sa brutalité ouatée, l'individu se trouve au cœur d'une double contrainte à laquelle il échappera de la seule manière possible : par l'investissement minimum. C'est ainsi que les grandes entreprises férues de stratégie militaire se privent de toute initiative personnelle, de toute implication désintéressée dans la vie de la société, de toute créativité, de toute imagination. Mais c'est là, bien-sûr, une conclusion qui n'est guère inattendue. La guerre, après tout, n'est pas un lieu de grande création. Il faut donc trouver d'autres modèles, basés sur la coopération, plus que sur la compétition.
La subir au quotidien conduit à une résignation malsaine, où finalement personne - ni employés, ni patrons - ne va trouver son compte. Cette violence réfrénée, ce passage à tabac de la dignité humaine qui se pratique à coup de chaussettes remplies de sable, ne laisse en apparence pas plus d'ecchymoses qu'elle ne laisse de choix. Être chair à canon ou sniper, fantassin ou commando, bref garder son éthique et être sacrifiable ou au contraire l'abdiquer et devenir une machine pour cette guerre sans autre cause qu'une course éperdue aux profits. C'est à dire une guerre de survie. Une guerre d'expansion en somme, mais qui se conduit de l'intérieur, et contre un ennemi désincarné, dont l'omniprésente menace fait planer sur tous un stress mortifère qui ne se résoudra que dans une violence inutile. Cela ne laisse au salarié pour seule solution de repli qu'une défensive résignée. Puisque cette inutile violence se redistribue en interne, on s'interdit tout esprit de corps, et chaque individu n'œuvrera par conséquent qu'à sa propre survie, et exclusivement à elle. Et si on lui demande de se battre, il ne le fera pas pour l'entreprise, par pour le marché, pas pour la hiérarchie. Non ! Il le fera pour garder sa place. Retour de flamme insolite - mais logique - de cette passion guerrière du monde du management : l'esprit mercenaire. Entre les codes ultra civilisés du monde des affaires et sa brutalité ouatée, l'individu se trouve au cœur d'une double contrainte à laquelle il échappera de la seule manière possible : par l'investissement minimum. C'est ainsi que les grandes entreprises férues de stratégie militaire se privent de toute initiative personnelle, de toute implication désintéressée dans la vie de la société, de toute créativité, de toute imagination. Mais c'est là, bien-sûr, une conclusion qui n'est guère inattendue. La guerre, après tout, n'est pas un lieu de grande création. Il faut donc trouver d'autres modèles, basés sur la coopération, plus que sur la compétition.
Peace, love and making money
Si l'ennemi est partout, cela revient à dire qu'il n'est nulle part. Un syllogisme dont la mise en œuvre demande bien plus de pragmatisme que son apparente évidence semblerait le laisser suggérer. Effectivement, toute entreprise est à la merci d'un rachat intempestif, d'une OPA hostile, d'un changement d'actionnaires. C'est aujourd'hui une donnée structurelle, mais surévaluée par sa nature imprévisible. La menace est là, mais tellement là qu'il est tout juste utile de s'en préoccuper. Plutôt que mobiliser toutes les énergies de son personnel à endiguer un danger qui, peut-être, ne se matérialisera jamais, et qui, si il le fait, ne vous laissera vraisemblablement aucune chance, pourquoi ne pas essayer de redistribuer ses forces pour développer des modèles alternatifs ? Pourquoi ne pas laisser enfin Sun Tzu reposer en paix, déposer les armes, et se rappeler que le commerce, c'est avant tout l'échange. Induire dans les rapports au sein de l'entreprise une dynamique de coopération, d'écoute, lui redonner une dimension humaine me semblerait être une attitude autrement plus constructive. Etant donné le temps considérable qu'y passent ses salariés, il est vital qu'ils s'y sentent bien, qu'ils s'y sentent en sécurité, et surtout considérés comme des êtres humains. C'est ce qu'on déjà compris certaines compagnies, dont l'exemple le plus connu est Google. Son "Googleplex" rassemble salles de repos, de sport ou de jeux, restaurants, cafétérias, autant d'endroits favorisant une propagation transversale de l'information. S'y nouent des relations imprévues, des connexions aléatoires, avant tout favorisées par la convivialité et les affinités humaines. Y naissent au final des idées qui viendront enrichir le capital intellectuel de la compagnie. Plutôt qu'une rationalisation à tout crin, Google a choisi d'instiller un peu de chaos dans l'ordre, d'accepter le risque de ne pas tout contrôler, pour finalement en tirer profit.  Ils ne sont pas les seuls, mais il est vrai que beaucoup d'entrepreneurs de la Silicon Valley sont très au fait des pensées contre-culturelles et alternatives, qui sont très tôt venues à la rencontre des nouvelles technologies. Evidemment, le management à l'américaine s'assure au final que cette apparente bonhommie reste rentable, voire très rentable. Mais il est frappant de constater que lorsqu'il touche nos côtes ce même "management à l'américaine" est débarrassé de tout ce qu'il peut avoir d'intéressant et de novateur, pour ne conserver que ces aspects les plus désagréablement dépassés, et s'inscrire dans cette vieille tradition d'exploitation du libéralisme le plus sauvage. Pire encore, cette spirale de la morosité, qui débouche sur une gestion suicidaire de l'humain en entreprise, et aboutit, en fin de compte à un constat d'échec, c'est sur les épaules des salariés qu'on va la faire reposer toute entière. "Les gens ne veulent plus travailler !", refrain connu entonné régulièrement par le MEDEF, qui en retour propose d'y remédier par une discipline de fer et le retour de la trique.
Ils ne sont pas les seuls, mais il est vrai que beaucoup d'entrepreneurs de la Silicon Valley sont très au fait des pensées contre-culturelles et alternatives, qui sont très tôt venues à la rencontre des nouvelles technologies. Evidemment, le management à l'américaine s'assure au final que cette apparente bonhommie reste rentable, voire très rentable. Mais il est frappant de constater que lorsqu'il touche nos côtes ce même "management à l'américaine" est débarrassé de tout ce qu'il peut avoir d'intéressant et de novateur, pour ne conserver que ces aspects les plus désagréablement dépassés, et s'inscrire dans cette vieille tradition d'exploitation du libéralisme le plus sauvage. Pire encore, cette spirale de la morosité, qui débouche sur une gestion suicidaire de l'humain en entreprise, et aboutit, en fin de compte à un constat d'échec, c'est sur les épaules des salariés qu'on va la faire reposer toute entière. "Les gens ne veulent plus travailler !", refrain connu entonné régulièrement par le MEDEF, qui en retour propose d'y remédier par une discipline de fer et le retour de la trique.
Il n'en reste pas moins que la solution, est effectivement entre les mains des décideurs, et pas entre celles de cette soldatesque dont ils ont voulu se doter. En France, l'employé n'est plus le collaborateur. D'ailleurs l'a-t-il jamais été ? Etrange lecture sélective des modèles, mais qui a au moins le mérite du confort, puisqu'il pérennise une tradition féodale du monde du travail, qui permet aux grands patrons de trouver des boucs émissaires commodes à leurs échecs.
Inédit

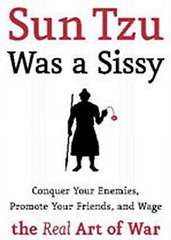 Le viatique indispensable du cadre efficace ne peut plus se concevoir, aujourd'hui, sans une édition poche de L'Art de guerre de Sun Tzu. Voilà bien qui est symptomatique de cette culture qu'on dit "d'entreprise". Oxymore ultime, car s'il est bien un monde où la culture est bel et bien bannie, c'est celui de l'entreprise.
Le viatique indispensable du cadre efficace ne peut plus se concevoir, aujourd'hui, sans une édition poche de L'Art de guerre de Sun Tzu. Voilà bien qui est symptomatique de cette culture qu'on dit "d'entreprise". Oxymore ultime, car s'il est bien un monde où la culture est bel et bien bannie, c'est celui de l'entreprise. Cette dichotomie dans la perception de la violence s'explique largement par l'illusion de civilisation dont elle s'affuble dès lors qu'elle franchit les limites des quartiers des affaires. Mais ce n'est pas la seule transformation qu'elle ait alors à subir. Car cette glorification du guerrier dans le cadre policé de l'entreprise, débouche sur un paradoxe dangereux.
Cette dichotomie dans la perception de la violence s'explique largement par l'illusion de civilisation dont elle s'affuble dès lors qu'elle franchit les limites des quartiers des affaires. Mais ce n'est pas la seule transformation qu'elle ait alors à subir. Car cette glorification du guerrier dans le cadre policé de l'entreprise, débouche sur un paradoxe dangereux. La subir au quotidien conduit à une résignation malsaine, où finalement personne - ni employés, ni patrons - ne va trouver son compte. Cette violence réfrénée, ce passage à tabac de la dignité humaine qui se pratique à coup de chaussettes remplies de sable, ne laisse en apparence pas plus d'ecchymoses qu'elle ne laisse de choix. Être chair à canon ou sniper, fantassin ou commando, bref garder son éthique et être sacrifiable ou au contraire l'abdiquer et devenir une machine pour cette guerre sans autre cause qu'une course éperdue aux profits. C'est à dire une guerre de survie. Une guerre d'expansion en somme, mais qui se conduit de l'intérieur, et contre un ennemi désincarné, dont l'omniprésente menace fait planer sur tous un stress mortifère qui ne se résoudra que dans une violence inutile. Cela ne laisse au salarié pour seule solution de repli qu'une défensive résignée. Puisque cette inutile violence se redistribue en interne, on s'interdit tout esprit de corps, et chaque individu n'œuvrera par conséquent qu'à sa propre survie, et exclusivement à elle. Et si on lui demande de se battre, il ne le fera pas pour l'entreprise, par pour le marché, pas pour la hiérarchie. Non ! Il le fera pour garder sa place. Retour de flamme insolite - mais logique - de cette passion guerrière du monde du management : l'esprit mercenaire.
La subir au quotidien conduit à une résignation malsaine, où finalement personne - ni employés, ni patrons - ne va trouver son compte. Cette violence réfrénée, ce passage à tabac de la dignité humaine qui se pratique à coup de chaussettes remplies de sable, ne laisse en apparence pas plus d'ecchymoses qu'elle ne laisse de choix. Être chair à canon ou sniper, fantassin ou commando, bref garder son éthique et être sacrifiable ou au contraire l'abdiquer et devenir une machine pour cette guerre sans autre cause qu'une course éperdue aux profits. C'est à dire une guerre de survie. Une guerre d'expansion en somme, mais qui se conduit de l'intérieur, et contre un ennemi désincarné, dont l'omniprésente menace fait planer sur tous un stress mortifère qui ne se résoudra que dans une violence inutile. Cela ne laisse au salarié pour seule solution de repli qu'une défensive résignée. Puisque cette inutile violence se redistribue en interne, on s'interdit tout esprit de corps, et chaque individu n'œuvrera par conséquent qu'à sa propre survie, et exclusivement à elle. Et si on lui demande de se battre, il ne le fera pas pour l'entreprise, par pour le marché, pas pour la hiérarchie. Non ! Il le fera pour garder sa place. Retour de flamme insolite - mais logique - de cette passion guerrière du monde du management : l'esprit mercenaire. Ils ne sont pas les seuls, mais il est vrai que beaucoup d'entrepreneurs de la Silicon Valley sont très au fait des pensées contre-culturelles et alternatives, qui sont très tôt venues à la rencontre des nouvelles technologies. Evidemment, le management à l'américaine s'assure au final que cette apparente bonhommie reste rentable, voire très rentable. Mais il est frappant de constater que lorsqu'il touche nos côtes ce même "management à l'américaine" est débarrassé de tout ce qu'il peut avoir d'intéressant et de novateur, pour ne conserver que ces aspects les plus désagréablement dépassés, et s'inscrire dans cette vieille tradition d'exploitation du libéralisme le plus sauvage. Pire encore, cette spirale de la morosité, qui débouche sur une gestion suicidaire de l'humain en entreprise, et aboutit, en fin de compte à un constat d'échec, c'est sur les épaules des salariés qu'on va la faire reposer toute entière. "Les gens ne veulent plus travailler !", refrain connu entonné régulièrement par le MEDEF, qui en retour propose d'y remédier par une discipline de fer et le retour de la trique.
Ils ne sont pas les seuls, mais il est vrai que beaucoup d'entrepreneurs de la Silicon Valley sont très au fait des pensées contre-culturelles et alternatives, qui sont très tôt venues à la rencontre des nouvelles technologies. Evidemment, le management à l'américaine s'assure au final que cette apparente bonhommie reste rentable, voire très rentable. Mais il est frappant de constater que lorsqu'il touche nos côtes ce même "management à l'américaine" est débarrassé de tout ce qu'il peut avoir d'intéressant et de novateur, pour ne conserver que ces aspects les plus désagréablement dépassés, et s'inscrire dans cette vieille tradition d'exploitation du libéralisme le plus sauvage. Pire encore, cette spirale de la morosité, qui débouche sur une gestion suicidaire de l'humain en entreprise, et aboutit, en fin de compte à un constat d'échec, c'est sur les épaules des salariés qu'on va la faire reposer toute entière. "Les gens ne veulent plus travailler !", refrain connu entonné régulièrement par le MEDEF, qui en retour propose d'y remédier par une discipline de fer et le retour de la trique. 
 Tags : monde de l'entreprise, violence en entreprise, suicides en entreprise, sun tzu, infra-violence, rapports humains, ressources humaines, l'art de la guerre, logique patronale
Tags : monde de l'entreprise, violence en entreprise, suicides en entreprise, sun tzu, infra-violence, rapports humains, ressources humaines, l'art de la guerre, logique patronale
